Classes-En-Lutte, mai 2021. Non le masculin ne l’emportera pas !
La sous-représentation des femmes dans les manuels scolaires, qui concourt à leur invisibilisation et la reproduction des stéréotypes de genre, est dénoncée depuis nombre d’années…
cel-mai-2021-VFNon le masculin ne l’emportera pas !
EI-9-Ref.-Circul.La sous-représentation des femmes dans les manuels scolaires, qui concourt à leur invisibilisation et la reproduction des stéréotypes de genre, est dénoncée depuis nombre d’années. Plusieurs études sur les manuels d’histoire, de maths ou d’EMC ont permis de montrer, entre autre, que seulement 3,2% des personnages historiques triés sur le volet sont féminins, que les femmes ne représentent que 28% des personnages de fiction, et qu’elles n’apparaissent dans l’ensemble de ces ouvrages à visée éducative qu’à hauteur de 20%. Quant aux secteurs d’activité, les hommes sont sur-représentés dans les domaines économique ou politique (environ 85% d’hommes contre 15% de femmes), tandis que pour illustrer un personnage effectuant des tâches ménagères, on retrouve encore des personnages féminins dans 60% des cas (1).
Le ministère a-t-il alors choisi d’intervenir pour promouvoir l’égalité, et dénoncer les représentations sexistes qui perdurent ? Évidemment que non. Au contraire, Blanquer, en bon réactionnaire, préfère taire toutes les tentatives de démasculinisation de la langue et des idées en tentant de proscrire l’enseignement et l’utilisation de l’écriture inclusive (2). Sous couvert d’un nationalisme putride, il reprend les arguments fallacieux de celles et ceux qui voudraient encore et toujours que le masculin l’emporte sur le féminin. Une fois de plus, le ministère veut entraver notre liberté pédagogique. Après nous avoir imposé des « évaluations nationales » à tous les niveaux pour nous forcer à bachoter dès la maternelle, il veut nous expliquer ce qu’est la langue française, tandis qu’il démontre par ses interventions qu’il méconnaît son histoire.
Et alors que ce ministère se plaît à orchestrer la confusion langagière par un usage outrancier de sigles à l’obsolescence programmée, il voudrait nous faire croire que ce serait l’illisibilité de l’écriture inclusive qui motiverait son bannissement. Pourtant, pour qui connaît a minima les rouages de la langue, il est évident que la graphie et la prononciation ne sont pas systématiquement en concordance parfaite. On imagine bien qu’au ministère personne ne dit : « euh té cé » pour « etc. ». Là où j’écris « bonjour à tou·tes », je prononce « bonjour à tous et toutes ». Une étude a par ailleurs mis en lumière que l’usage des doublons ou de leur forme abrégée avec le point médian pouvait, dans un premier temps, ralentir la lecture, mais que dès la deuxième occurrence, celle-ci redevenait tout à fait normale par effet d’habituation (3). On ne peut pas non plus rejeter l’ensemble comme le fond de la démarche, sous prétexte qu’une ou plusieurs de ces modalités, comme le point médian, ne font pas consensus. En réalité la plupart des modalités de l’écriture inclusive (accord du nom de métier avec le genre de la personne désignée, accords de proximité, double flexion et usage de termes épicènes) sont très logiques et donc simples. Et puis rien ne nous empêche dans le même temps de continuer à chercher d’autres signes typographiques plus lisibles, ou voyelles, ou syllabes qui a fortiori permettraient aux personnes intersexes et agenres de ne pas être invisibilisé·es/nié·es non plus. Cependant, hypocrite comme il sait si bien se montrer, Blanquer ose, sans le moindre complexe, se cacher derrière la défense des jeunes souffrant de troubles « dys ». Alors qu’il œuvre, depuis son arrivée à la tête de l’Éducation Nationale, à dégrader méticuleusement la situation des élèves, comme des personnels dits A .E .S .H., chargé·e·s de les accompagner et de les soutenir tout au long de leur parcours avec, par exemple, un accueil désastreux des enfants et jeunes souffrant de handicap par, entre autres, les effectifs surchargés, des statuts et salaires misérables et précaires, une formation du personnel d’accompagnement (cf. droit à compensation) quasi inexistante, et en faisant endosser aux familles des élèves à besoin éducatif particulier le recrutement de ce même personnel. Sans compter qu’on ne peut imputer à la seule écriture inclusive certaines difficultés d’apprentissage. De fait, l’ensemble de la langue est d’une grande complexité, et chacun·e sait que seuls les moyens humains permettent un réel accompagnement individualisé de qualité. En outre, lorsqu’un contenu pose difficulté d’appropriation, et selon les règles en vigueur dans notre métier, il est censé appartenir au/à la pédagogue d’adapter sa pédagogie à ses élèves. Pédago quoi ? Blanquer, chantre insidieux du « lire, écrire, compter et obéir », préfère instrumentaliser le handicap pour mieux bâillonner ! La féminisation des noms de métiers qu’ont concédé, non sans peine, les instances les plus réactionnaires avait peut-être vocation à nous anesthésier, mais l’on ne peut s’en contenter. Et pourquoi celleux qui tempêtent contre une complexification abusive de l’écriture inclusive ne s’opposent-iels pas dans le même temps aux complexifications abusives, illogiques, et plus qu’incommodes introduites par les académicien·nes et autres pseudo-grammairien·nes, aux seules fins de distinction sociale ? Ne laissons plus ces soit-disant « immortel·les » invoquer une beauté perdue (à la manière de Pangloss, vision d’une harmonie pré-établie avec son « meilleur des mondes possibles »…) qui se limiterait à l’application de règles absurdes. Et ne les laissons pas plus appauvrir et figer une langue dans une pseudo-pureté, totalement affabulée. Laissons plutôt les prof·es, élèves, locuteurs/locutrices et les linguistes continuer à chercher, réinventer et construire une langue et une grammaire qui leur conviennent. Puisque c’est justement l’Usage, par la participation active de tou·tes, que l’on peut considérer comme une sorte d’autogestion spontanée, qui fait qu’une langue reste expressive et vivante.
De plus, les pourfendeur·ses de l’écriture inclusive semblent prétendre que la grammaire serait immuable, bien qu’incapables de démontrer la véracité de leurs propos. Et pour cause, puisque c’est scientifiquement et historiquement faux. Iels se limitent à faire usage de rhétorique, en brandissant citations et arguments d’autorité, pour finir par se ridiculiser en faisant référence à l’Académie française. Cette institution, créée en 1634 par Richelieu (4), instaure les bases de ce que l’on appellera plus tard « la politique linguistique ». Cette création de la monarchie absolue, qui vise à standardiser le français et à inventer une norme unique, prémices d’une « novlangue », a pourvu au fil des siècles des sièges sur des critères politiques ou militaires. Ainsi, alors que l’État trouve toujours des expert·es pour dire une chose et son contraire, le constat est flagrant : les académicien·nes ne sont ni historien·nes, ni sociologues, encore moins pédagogues, et les linguistes y sont plus que largement minoritaires. Au mieux, on pourrait les qualifier de lexicographes, dont la parole n’a aucun poids normatif. Qui plus est, cette dernière entreprise de dénigrement de l’écriture inclusive ne s’est pas contentée de masquer la réalité des attaques masculinistes, assidues, et de longue haleine, qui ont abouti à la construction historique de ces fâcheuses règles sexistes : ils (5) y ont activement participé ! Ainsi, il y a quatre siècles, cette fameuse Académie fronçaise s’est bel et bien bien rendue responsable de la suppression des noms de métiers féminins. En l’occurrence ceux, et cela ne doit rien au hasard, liés à des fonctions considérées comme prestigieuses, donc devant être réservées aux hommes (cf. « autrice », « ambassadrice » ou « doctoresse »). Loin de toute considération linguistique ou grammairienne, et au mépris des logiques qui fondaient l’usage du français de l’époque. On lui doit aussi la suppression de l’accord de proximité (à l’usage courant jusqu’alors), et l’affirmation péremptoire de la supériorité du genre masculin, au motif éminemment politique de « la supériorité du mâle sur la femelle » (dixit le boomer avant l’heure et grammairien N. Beauzée) (6). Déjà à cette époque, les enjeux étaient limpides : il ne s’agissait pas de « défendre la langue », mais bien de mettre en œuvre tous les rouages possibles de la domination masculine et de l’ordre patriarcal.
Derrière l’absurde prétendue neutralité du masculin se cache en réalité l’objectif politique de l’invisibilisation de la place des femmes dans l’histoire et dans la langue, portant appui à l’enracinement de rapports sociaux de genre inégalitaires. Il n’est plus à démontrer que les normes linguistiques ont un effet performatif, contribuant à ancrer durablement des représentations genrées des rôles et activités sociales (7) (l’infirmière et le médecin, la secrétaire et le directeur, etc.) avec des conséquences très pragmatiques sur les choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles, dont le degré de confiance peut dépendre du caractère inclusif ou non du langage (8). Avoir recours à l’écriture inclusive, et donc à l’inéluctable démasculinisation de la langue, a pour principal objectif l’égalité. C’est donc une vocation à la fois politique, sociale et pédagogique. À nous de faire en sorte que la langue ne soit plus un outil d’infériorisation ou de division, à plus forte raison avec des règles sexistes que l’on ne peut plus admettre. Nous ne devrions pas la subir. C’est celle-ci qui devrait s’adapter aux normes plus progressistes de nos sociétés contemporaines. À nous également de mettre tou·tes nos élèves sur un véritable pied d’égalité, quelque soit leur genre. Il est tout bonnement impossible (et insensé) que l’on utilise le masculin pour parler à l’ensemble d’une classe composée, en partie ou en majorité, de filles.
N’oublions pas non plus qu’aujourd’hui encore, en France : une femme est violée toutes les 7 minutes, une femme est tuée par son compagnon ou son ex tous les 3 jours, 220 000 femmes sont victimes de violences chaque année, leur salaire est de 30 % inférieur à travail égal, 80 % des temps partiels sont occupés par des femmes… Cela est rendu possible par tout un tas de processus convergents, qui leur font croire dès la prime enfance qu’elles ne sont que des êtres de seconde zone. Processus parmi lesquels cette règle de circonstance, imposée à toute force et contre toute logique antérieure, impliquant (et même ayant été affirmé) qu’elles n’ont même pas suffisamment de « valeur » pour être reconnues ou nommées, dès lors qu’un homme se trouve parmi elles. Ces données ne devraient-elles pas nous faire prendre conscience qu’il y a urgence à lutter contre le patriarcat, et à faire évoluer mœurs et esprits ? Il serait naïf de penser que changer la langue peut changer les mentalités. L’amélioration de la langue n’est bien entendu pas plus un levier unique que suffisant, mais cette évolution n’en est pas moins indispensable. Ne pense-t-on pas aussi avec des mots ? Les sciences du langage, mais aussi des études de sociologie, de psychologie cognitive et de psychologie sociale nous permettent de ne plus ignorer que « la langue et la société ont un rapport dialectique : nous façonnons la langue, et la langue nous façonne, dans un va-et-vient perpétuel » (9). Le langage influence nos représentations mentales et ce qui n’est pas nommé peut difficilement exister. Alors empêchons que les petites filles, et toute personne subissant un état d’intersexualité, reçoivent ces coups de poing symboliques, à un âge auquel on peut difficilement contester.
Ainsi, usons également de rhétorique avec un argument d’autorité (et fort sensé !) en la parole de Roland Barthes (10): « Toute langue, puisqu’elle a pour fonction principale de décrire le monde et la société dont elle émerge, est révélatrice des pratiques et des valeurs de celle-ci […] car elle hiérarchise, sélectionne et organise la société, dans le champ de la parole mais aussi des représentations, ayant ainsi un impact réel sur les façons de penser et d’agir. En effet, elle conditionne notre vision du monde et nous oblige à penser d’une certaine manière ».
Alors que la paresse linguistique des dominantEs tentent de freiner la volonté de façonner une langue véritablement inclusive ; pendant que d’autres se bercent de l’illusion que ces faits de langue n’ont aucune portée symbolique et pragmatique. On pourrait déjà viser un peu plus d’égalité, avec un pied de nez qui ne serait évidemment pas une fin en soi mais un moyen de démontrer par les faits. Ainsi, pourquoi ne pas se jouer de ces règles ineptes en nous amusant à employer le féminin générique et la règle du féminin qui l’emporte sur le masculin? On peut sans difficulté imaginer qu’une telle expérimentation, que l’on pourrait envisager, par exemple, une semaine par an, autour du 8 mars, ou plus équitablement la moitié de l’année , en plus de son potentiel émancipateur, pourrait faire entrevoir aux récalcitrantEs, à quel point, finalement, ces questions-là n’ont rien d’anecdotique.
Autrement dit, quelques soient les injonctions autoritaires, réactionnaires et régressives du ministère, nous continuerons à lutter pour une éducation antisexiste et, par conséquent, émancipatrice !
(1) Centre Hubertine Auclert, 2012, 2013, 2015, 2017. Observatoire des inégalités, « La place des femmes dans les manuels scolaires », 2013.
(2) Circulaire du 05-05-2021. https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo18/MENB2114203C.htm
(3) P. Gygax, N. Gesto, « Féminisation et lourdeur de texte », 2007.
(4) https://www.academie-francaise.fr/linstitution-lhistoire/les-grandes-dates
(5) A l’époque, pas la moindre femme ne pouvait prétendre à l’éternité… Et depuis, tous comptes faits, 10 femmes pour 737 académiciens ont occupé les sièges, parfois fort convoités. Voilà pourquoi l’accord selon le sens s’impose, cette institution ayant péniblement atteint le taux de 1,36% de femmes en son sein sur près de 4 siècles…
(6) É. Viennot, Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! : petite histoire des résistances de la langue française, 2014. É. Viennot, L’Académie contre la langue française : Le dossier « féminisation », 2016.
(7) M. Brauer, « Une ministre peut-il tomber enceinte ? L’impact du générique masculin sur les représentations mentales », 2008.
(8) A. Chatard, S. Guimont, D. Martinot, « Impact de la féminisation lexicale des professions sur l’auto-efficacité des élèves : une remise en cause de l’universalisme masculin ? », 2005.
(9) M. Candéa, L. Véron, Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique, 2019.
(10) Leçon inaugurale au Collège de France du 7 janvier 1977.
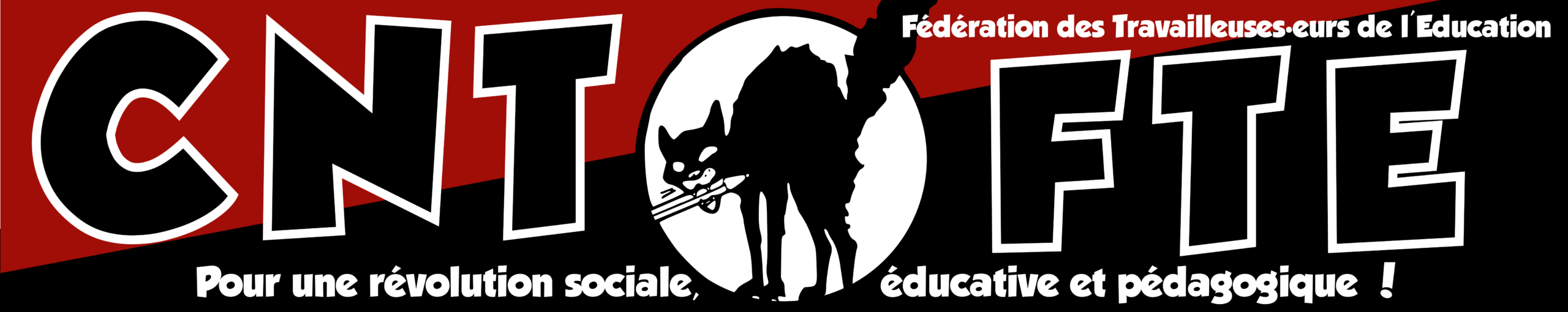

2 thoughts on “Classes-En-Lutte. Non le masculin ne l’emportera pas !”
Les commentaires sont fermés.